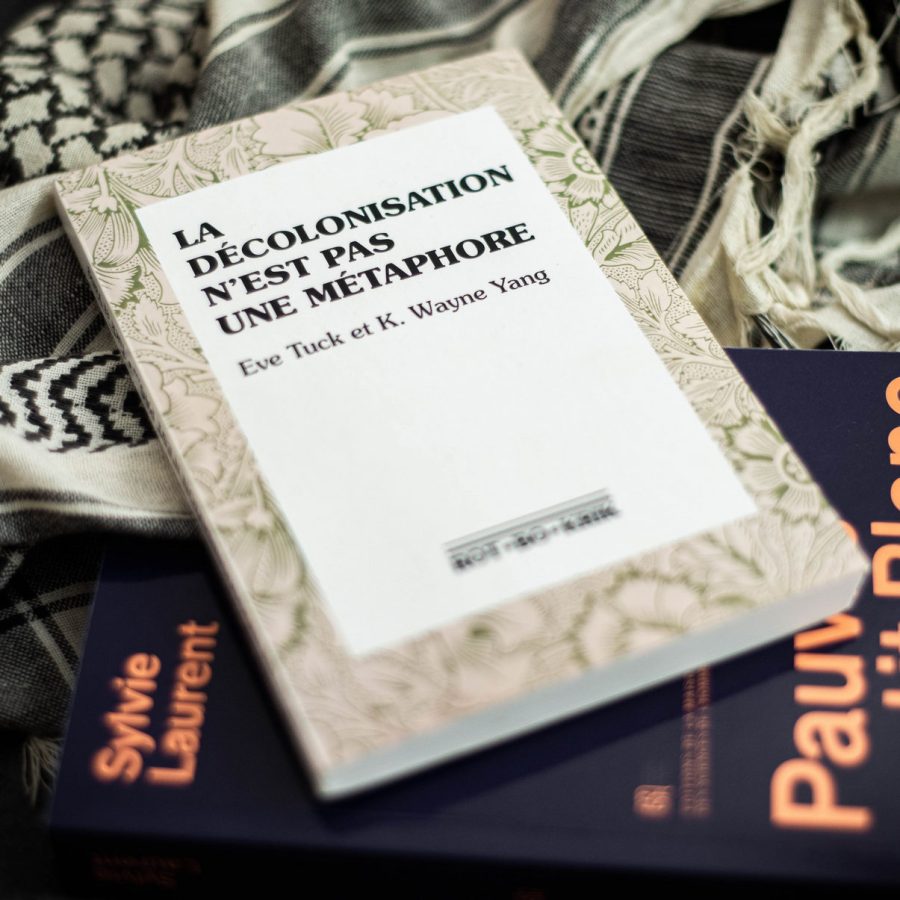De Tuck Eve et Yang Wayne
Chez Ròt-Bò-Krik
Traduction de Jean-Baptiste Naudy
2022
« La décolonisation entraîne la restitution aux autochtones de leurs vies et de leurs terres ; elle n’est pas une métaphore d’autre chose que nous chercherions à faire advenir pour améliorer nos sociétés ou nos écoles. »
L’usage militant du terme « décoloniale » en fait une métaphore, « décoloniser les écoles, la pensée,… ». Ces luttes sont importantes mais ne sont pas la décolonisation.
La décolonisation comme métaphore peut servir aux colon·es comme moyen de disculpation, comme moyen de se garder un avenir en tant que colon·es.
Les théories postcoloniales et celles de la colonialité considèrent 2 formes de colonialité :
- Colonialisme externe : expropriation des mondes autochtones par fragment (plantes, êtres humains, ressources,…) au profit des colonisateurices. Cela englobe également des intérêts contemporains comme le petrol. Tout ce qui est autochtone se voit traité comme une « ressource naturelle ».
- Colonialisme interne : la gestion des personnes, terres, faune et flore au sein des frontière de la nation impériale, via des modes de contrôles particuliers (écoles, ghettoïsations,prison, minorisation…) afin de garantir l’ascendance blanche.
Aucune de ces 2 formes ne décrive suffisamment le colonialisme de peuplement dans lequel il n’y a pas de séparation spatiale entre la colonie et la métropole, c’est un colonialisme à la fois interne et externe (comme avec les USA par exemple).
La colonisation de peuplement exige une appropriation totale du monde autochtone et particulièrement des terres qui représentent pour les colon·es de nouvelles sources de capital et dont l’expropriation constitue une profonde violence pour les autochtones.
« Les colons ne sont pas des immigrants », car les immigrant·es sont tenues de respecter lles lois autochtones alors que les colon·es deviennent la loi.
« Les nations issues du colonialisme de peuplement ne sont donc pas des nations d’immigrants. »
Les États nations de peuplements sont également des empires, ces projets amènent des individus dépossédé·es sur des terres autochtones saisie (comme se fut le cas des personnes esclavagisé·es envoyé·es en Amérique). Les sujets coloniaux déplacé·es (externes) ou racisé·es (internes) se retrouvent à occuper des terres volées, ce qui complexifie la décolonisation, car des individus originaire et victimes de contextes coloniaux se retrouvent colons dans d’autres contextes. La décolonisation comme métaphores permet d’éviter ses contradictions en faisant de la décolonisation un signifiant vide.
Dans un contexte colonial de peuplement, la décolonisation doit impliquer la restitution des terres. Les sociétés de peuplement coloniales tendent à détruire ou à assimiler les autochtones pour les faire disparaître et ainsi faire des colon·es des autochtones.
La décolonisation comme métaphore, réduite aux revendications de justice sociale est un moyen pour les colon·es d’esquiver leur complicité.
Janet Mawhinney a analysé comment la narration et l’auto-confession servent aux blanc·hes à mettre en équivalence des récits d’exclusions personnelles avec des récits d’exclusion structurelle. Elle théorise également l’auto-positionnement des blanc·hes comme opprimé·es et jamais comme oppresseureuses et cela malgré notre absence d’expérience de relation de pouvoirs oppressif raciste.
Elle a aussi pointé ce qu’elle nome « manœuvres de disculpations », qui sont les stratégies de déculpabilisation des colon·es. Les manœuvres de disculpations des colon·es servent à se déculpabiliser sans pour autant renoncer au pouvoir et aux terres, voire cela est parfois valorisé que de manifester une telle conscience de soi et de sa position.
Manœuvre 1 : Nativisme colonial
Lae colon·e se trouve un·e ancetre autochtone et se détourne alors de son identité de colon·e tout en continuant à profiter des avantages de cette position de colon·e.
C’est une forme d’appropriation d’une identité autochtone afin de continuer la domination coloniale.
Manœuvre 2 : Fantasme d’adoption (ou désir d’être devenu sans devenir)
C’est l’adoption de pratiques et savoirs autochtones ainsi que l’imaginaire créant des récit où les autochtones confiraient leurs terres, leurs luttes, au colon·e.
C’est le fantasme d’être « adopté·e » par un peuple autochtone, ce qui absous lae colon·e des crimes coloniaux et rend la décolonisation caduque car lae colon·e est maintenant autochtone.
Manœuvre 3 : L’équivoque coloniale
Homogénéiser diverses expériences d’oppressions sous le nom de colonisation, faisant alors d’une bonne part des luttes pour la justice sociale, des luttes décoloniales et niant le statut de colon·es de nombre d’entre elleux.
Les projets anti/post-coloniaux ne défont pas le colonialisme mais cherchent à le subvertir, à partir à la recherche des ressources volées par la colonisation, ce qui n’est possible que par l’occupation des terres.
L’équivoque c’est quand la lutte anti-coloniale n’avance pas la nécessité de désoccuper les terres, quand ces luttes font des sujets post-coloniaux des sujets ayant accès aux privilèges fournis par la métropole,… sans poser la question de la souveraineté des sujet coloniaux.
Manœuvre 4 : « Free your mind and the rest will follow »
Mettre ses forces uniquement sur la décolonisation des esprits, réduire la décolonisation à une conscientisation (même si cela reste une étape importante, ce n’est pas suffisant).
Manœuvre 5 : Les peuples à(sté)risque
Académiquement, les peuples autochtones sont perçus comme « à risque » (d’extinction) ou « en astérisque » (dans les données étudiées, ils sont renvoyés à une « * » en bas de page) donc pas vraiment pris en compte.
Ainsi, si la recherche en science sociale ou en éducation, compte les personnes autochtones, c’est en les effaçant, en les excluant ou en les intégrant mais sans réelle prise en considération.
Manœuvre 6 : ré-occuparion et fermes urbaines
Les discours de redistribution des richesses (comme pendant le mouvement Occupy) dans une colonie de peuplement, oublient souvent qu’une grande part des richesses en question sont des terres ; et que redistribuer les richesses veut donc dire se repartir les terres occupées entre colon·es (et une faible part d’autochtones).
La décolonisation implique l’appauvrissement de 99 % des colon·es.
« La décolonisation supprime les droits de propriétés des colon·es et leur souveraineté. »
C’est une façon de se disculper grâce à la supériorité numérique des colon·es, sous prétexte du surnombre de colon·es, la terre ne devrait pas revenir et être sous la souveraineté des autochtones mais de toustes (donc surtout des colon·es).
Une décolonisation matérielle et non métaphorique remet en question certaines luttes émancipatrices qui se pensent décoloniales.
Les luttes anti-coloniales tournées vers l’internationale peuvent amener à ignorer le contexte colonial précis dans le quel on évolue.
« La décolonisation nécessite de changer l’ordre du monde. »
La réconciliation ne vise qu’à préserver l’avenir des colon·es. La décolonisation ne vise pas l’égalisation par incorporation comme peuvent le faire les luttes pour les droits humains et civique, elle vise la souveraineté des autochtones. L’objectif n’étant pas d’inverser l’ordre colonial mais de le détruire.
Autres ressources :
- Les 9 revendications de Felix Tiouka 1984
- La domination policière de Mathieu Rigouste chez La Fabrique
- Pour une écologie pirate de Fatima Ouassak chez La decouverte
- Pauvre petit blanc de Sylvie Laurent chez La Maison des sciences de l’Homme
- Le travail de Histoires crepues
- Le podcast Des Colonisations